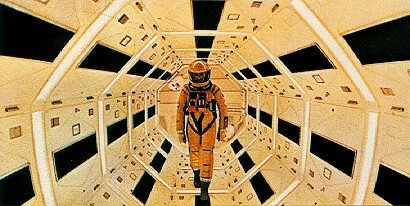Blade Runner de Ridley Scott.
Avec Harrison Ford, Sean Young, Rutger Hauer.
Blade Runner est un film qui a une histoire. Réalisé en 1982 par Ridley Scott (qui devra pour cela abandonner un grand projet : « Dune », finalement signé par David Lynch), celui-ci sera d’abord vivement dénoncé à sa sortie par les critiques de l’époque. Le film connaîtra cinq versions successives, et peut être même qu’une sixième verra le jour, attendue des fans pour 2007.
Toutes ces versions résultent en fait d’une guerre de droits d’auteur entre la Warner d’un côté, et Ridley Scott de l’autre. Aujourd’hui, le film a plus que bien résisté au temps, puisque celui-ci continue d’être admiré. Un sondage du quotidien Britannique « The Guardian » auprès des 60 plus grands scientifiques mondiaux l’a même consacré meilleur film de sciences fiction de l’histoire du cinéma[1][1].
Pourtant, le film a été un échec financier, et n’a eu son salut que dans sa redécouverte, à travers la vidéo, par des groupes de fans qui se sont mis à écrire sur ce film aux multiples facettes, qui touche à plusieurs genres, et montre le visage d’un Los Angeles comme une mégalopole labyrinthique, inextricable, inhumaine, démesurée, cimetière des âmes.
A travers ce film, d’une grande poésie, très touchant, nous nous trouvons aux prises avec plusieurs « problématiques ». A elle seule, l’œuvre traite de la destinée de l’humanité, des rapports entre le progrès scientifique et son utilisation, de la hiérarchie sociale, de l’homme face à l’histoire, à la mort. On peut tout à fait y voir également une parabole sur le rôle du cinéma dans la construction de l’histoire des hommes.
Le film est un croisement tout à fait audacieux puisqu’il associe des techniques et effets spéciaux de pointe pour un film profond, symbolique, contemplatif et poétique (oui, tout cela).
Un bref résumé.
Nous sommes en 2019, dans un monde où la nature a été quasiment éliminée du globe par des guerres radioactives. Une politique volontariste de colonisation de Mars a poussé un grand nombre d’habitants à quitter leur habitation sur terre. En échange, ils reçoivent un robot à apparence humaine. Une révolte de ces « réplicants » leur interdit tout retour sur terre, ce qu’un groupe parviendra pourtant à faire après une mutinerie, dans le but d’échapper à leur mort, puisque leur durée de vie est limitée.
L’histoire du film est donc la lutte entre un flic (Rick Deckard/Harrison Ford) membre d’une unité d’exterminateurs de réplicants, les « Blade Runner », et ces mêmes androïdes, vivant cachés, et cherchant à rencontrer le patron de la plus grande entreprise de fabrication de robots à apparence humaine, Tyrell de la Tyrell Corporation, afin d’y chercher le remède à leur vieillissement accéléré.
Au cours de ses recherches, Deckard va être amené à rencontrer la secrétaire de Tyrell, Rachel, androïde qui s’ignore. Il en tombera profondément amoureux. Les réplicants rebelles, emmenés par leur chef Roy, iront dans la maison d’un ingénieur travaillant pour la Tyrell Corporation pour mieux rentrer en contact avec son président. C’est dans cet immense immeuble déserté et décrépit que l’ultime bataille se déroulera. Invité à éliminer la dernière des réplicantes, Rachel, Deckard rejoint celle-ci. La dernière image est celle d’un ascenseur se refermant sur une musique angoissante.
Le film est une interprétation assez libre d’un texte (plus précisément : une nouvelle qui inspirera un livre) de Philip K. Dick, « Do Androids dream of electric sheep » (« les androïdes rêvent-ils de moutons électroniques ? », 1968[2][1]). Nous disons bien « assez libre » car le roman s’attache à décrire un personnage marié qui élève… un mouton électronique ! Certains critiques n’apprécieront pas cette libre adaptation (Philippe Manœuvre, dans le numéro 79 de Metal Hurlant, sorti au moment du film, parlera de seconde mort pour l’écrivain). C’est le même auteur qui inspirera un autre long métrage de science fiction, très réussi également : « Minority Report » de Spielberg sorti en 2002.
On pourrait parler longuement de la musique du film, mélange entre bruits de fond et mélodies, composée par Vangelis, qui est décidément un maître en la matière. Les sons rentrent en résonance avec l’immensité et l’impression de désarrois que laisse la ville. Poussant la nostalgie d’une ère que l’on semble regretter à son paroxysme, Vangelis placera quelques solos de saxophone, notamment pour les scènes d’intimité entre Deckard et Rachel, ainsi qu’un titre de crooner des années 40 : « one more kiss, dear ».
La bataille des versions.
Nous devons nécessairement toucher deux mots des différentes versions, et de la guerre qui se déroulera entre Scott et la Warner. Pour faire simple, on retiendra deux versions : celle de la sortie nationale de 1982, que le grand public a pu voir, et celle de 1992, à l’occasion des 10 ans du film, quand Scott tentera de rétablir sa version originale. Il sera empêché de le faire jusqu’au bout (ultimatum de la Warner), d’où l’intention d’en sortir une version d’auteur finale pour 2007.
Il ne s’agit pas de détails, mais de deux visions du film totalement incompatibles. Lors de la sortie, Harisson Ford est extrêmement populaire auprès des jeunes pour des films comme Star Wars (épisode 4 : 1977, épisode 5 : 1980) ou Indiana Jones (L’arche perdue : 1982). La fin troublante du film où le héros a finalement le choix entre la fuite (son amour), et l’élimination de celle qu’il aime (son devoir), ainsi que le rôle de Ford comme flic looser pousse
la Warner
à retoucher le film, sans d’ailleurs en parler au préalable à Scott. Ford sera un vrai flic humain (pas de doute sur son éventuelle appartenance à la race des réplicants, donc…) et la fin sera une escapade amoureuse entre Rachel et Deckard, avec une forêt en arrière plan. Pour cette fin, la production n’hésitera pas à se servir de rushs inutilisés du film de Kubrick, Shining. Tous les longs plans de la ville, toutes les longueurs contemplatives (qui forment la poésie et la force esthétique du film) seront accompagnés de commentaires par la voix (off) de Ford « expliquant » les scènes aux spectateurs, à qui il faut bien tout expliquer parce que sinon, ils s’ennuient, n’est-ce pas.
Du coup, ce qui faisait la lente beauté du film par des plans d’une grande intensité, laissant le spectateur seul devant l’immensité de la ville, devant l’isolement du héros, sera réduit considérablement. De plus une fin ouverte, libre et angoissante, terriblement sombre, se transformera en conte de fée.
C’est cette version finement découpée à la hache, ainsi que l’hostilité première des critiques, qui feront de Blade Runner un film très vite éliminé des écrans quelques semaines après sa sortie.
La force des hommes étant plus forte que celle des appareils, la beauté de l’œuvre ressurgira grâce à son créateur pour s’imposer comme « la » version connue maintenant de tous comme étant la véritable version.
Le mélange des styles : la science fiction en noire…
A première vue, Blade Runner est un film de science fiction. Cela se passe dans un futur qui n’a quasiment plus rien de commun avec la planète que nous connaissons et les avancées technologiques sont énormes. Des voitures volent dans le ciel, les robots sont semblables aux hommes, sont doués d’intelligence, et surtout, la planète est en crise entre la surpopulation, à la surindustrialisation, en même temps que la pauvreté, les malformations et le chaos règnent.
Ces éléments de science fiction vont être utilisés dans le but de faire un film reprenant une série de codes très caractéristiques du cinéma américain des années 40, appelé le cinéma « noir ».
Noel Simsolo, qui a écrit une bible du cinéma noir dans la collection « Essais » des publications des Cahiers du Cinéma (« Le film noir, vrais et faux cauchemars », 2005) notera à la fin de son livre une référence à Blade Runner, comme montrant l’influence des films noirs américain.
Ce croisement n’est pas du au hasard. Il est volontaire, dans le but de parler de l’avenir sous un angle réaliste et pessimiste.
L’ensemble des éléments est là, et forme la symbiose entre les genres. L’action se déroule dans une mégalopole à la lumière inexistante ou artificielle. La pollution a créé un épais nuage de fumée qui empêche le soleil de briller dans le ciel. Nous avons donc une ville très sombre, immense, et dont les rues sont envahies par la fumée. Cette lumière blafarde en provenance des néons de la ville ou des bureaux des grands buldings, souvent utilisée en contre-jour, sera également très présente dans le Alien du même Ridley Scot, tourné trois ans auparavant. Le grand isolement du vaisseau, l’absence de lumière véritable, les vapeurs : tous ces éléments rapprochent d’ailleurs beaucoup l’ambiance des deux films.
Comme dans les films des années 40, le héros est un flic désabusé, rongé par son passé (si tant est qu’il en ai un), qui vit à la marge, dont les actes de gloire sont tombés en désuétude.
La femme fatale apparaît sous les traits d’une belle androïde, à la grâce éblouissante, de haut standing. D’une grande assurance, elle passera par les étapes classiques de l’enchaînement amoureux et de la fragilité.
Les codes traditionnels sont d’une intensité décuplée. La ville sombre et brumeuse se transforme en temples sans limite plongée dans l’obscurité permanente. Le personnage sera soupçonné de n’être qu’une simple invention, pétri de peur, ne remportant la compétition finale qu’avec la clémence du chef des réplicants à qui l’on ne prêtait aucune âme, aucun sentiment. La femme fatale sera d’une beauté pure et touchante, pour tomber de très haut face à la découverte de sa propre nature « synthétique ». En effet, dans les films noirs traditionnels, la femme fatale se retrouve finalement fragilisée, se montre souvent amoureuse, voir blessée. Ce passage d’un stade d’objet inaccessible à celui d’oiseau blessé est décuplé ici, puisque Rachel va être ramenée à la réalité brutalement, dans un geste quasiment d’agacement de la part d’un Dekard fatigué, lui dévoilant les secrets de son intimité comme étant des implants-souvenirs provenant d’une autre personne (la nièce de Tyrell).
On pourra également noter que la trame de l’histoire rapproche également le film d’un drame, où l’amant devra choisir entre sa mission et son amour, et où la tragédie finale sera suggérée, sans que l’on soit sur qu’elle arrive vraiment (ce qui procure cette sensation de tension très forte à la fin du film, qui semble se prolonger dans le générique).
Si les éléments de science fiction viennent appuyer, décupler un film de genre, on peut également affirmer qu’en retour, les codes du films noirs viennent appuyer un regard sur l’avenir aussi sombre que la place de l’homme pris individuellement parait désespérée pour Ridley Scott. Car le regard porté sur l’avenir est résolument désespéré, et non sans rapport avec le présent.
L’excroissance de la réalité…
A bien y regarder, le monde dépeint dans Blade Runner est en grande partie inspiré de la réalité. Los Angeles a toujours ses quartiers découpés ethniquement (le film débute à China Town). La ville est toujours présentée comme immense, la police y est partout présente. Nous ne sommes pas en face d’une ville profondément aménagée, mais dont les caractères sont poussés à leur paroxysme.
La présence de la police, caractérisée par les bruits de sirène en temps normal dans nos films contemporains, se présente sous la forme de contrôles systématiques (y compris le héros, flic d’élite en quelque sorte, sera importuné par un contrôle de pure routine). Son pouvoir semble sans faille, puisque le supérieur de Deckard, Bryant, obtiendra l’engagement du héros pour une mission de « retrait » (comprendre : élimination des réplicants) en lui indiquant, tout sourire, que celui-ci n’a pas d’autre choix que d’accepter. Cette assurance dans les ordres donnés ira jusqu’à la demande du sacrifice de l’être aimé.
Puis il faut se pencher sur une contradiction qui pénètre toute la longueur du film : le paradoxe apparant, criant, entre une capitale industrielle, des progrès techniques gigantesques, la promesse d’expansion galactique et… la triste réalité du quotidien des habitants de la planète. On suit le personnage, seul, isolé, dans une foule anonyme, compacte, et surtout, à la fois désenchantée et résolument pauvre. A plusieurs reprises, on voit des panneaux de publicité envahir le ciel, les immenses gratte-ciel, répétant un même message d’invitation à conquérir l’espace en peuplant les colonies de l’espace, El Dorado hypothétique, tant les discours apparaissent irréels face à la misère terrestre. Les progrès, finalement, ne seront montrés que sous l’angle du renforcement des possibilités de contrôle policier et de création d’êtres servant de main d’œuvre largement exploitables (Pris, la belle réplicante, est même une esclave sexuelle, chargée de divertir les troupes militaires des colonies). La réalité matérielle, elle, tranche avec le discours, apparaît d’autant plus désespéré : une fois le clin d’œil de la Geisha visionné, on est confronté à la misère, aux bars sordides.
L’idée que se fait Scott de l’avenir est une version assez froide du monde qui nous entoure : le progrès technique est souvent évoqué, et pourtant, la réalité ne semble que prendre en considération ses aspects les plus régressif. Le développement des maladies, des malformations est la conséquence d’une utilisation belliqueuse des apports des sciences. L’expansion ne se fait que sur la base de la destruction, et si la vie rêvée des colonies de l’espace est utilisée comme slogan publicitaire, le résultat visible est surtout la désertion de certains quartiers laissés à l’abandon. C’est cet élément qui explique qu’à côté de la surpopulation, l’immeuble de JF Sebastien sera entièrement vide, délabré, fuyant de toute part, les décors baroques partant en miettes.
… qui reste la réalité. La dimension réaliste de Blade Runner.
Nous avons dit plus haut que la ville n’avait rien de commun avec la planète que nous connaissons actuellement. Ce n’est que partiellement vrai. A bien y regarder, on a une impression étrange dès le début du film. Alors que les voitures planent dans le ciel, que la ville est immense, on retrouve Deckard aux abords d’une guinguette asiatique, négociant son nombre de sushis avec un commerçant coriace. Avant cela, il lisait son journal devant un magasin de téléviseurs.
L’une des forces du film vient d’un souci extrême du détail et d’une réflexion de Scott, très tatillon sur les décors (beaucoup de récits à ce sujet), qui amènera le réalisateur à vouloir mêler des éléments futuristes à un monde qui ressemble sur certains points au nôtre. Il y a donc dans tout le film, un fourmillement d’objets, d’attitudes, d’habitudes, de métiers, qui nous rappellent un certain quotidien.
Scott fait ici de la dialectique sans le savoir (ou en le sachant, on est pas dans son esprit) : toute civilisation contient et dépasse le stade précédent de l’humanité. Chaque étape est donc la négation de la précédente, mais en même temps, elle ne l’annule pas complètement. Appliquée à la science-fiction, on doit nécessairement retrouver des « restes » de notre époque actuelle. Cet élément maîtrisé, Blade Runner se veut un film cherchant réellement une représentation du futur, et non la simple invention d’un monde dans le futur. Les avancées techniques sont donc à la fois puissantes, tout en restant réalistes. Nous avons donc des publicités pour Coca-Cola, le commissariat ressemble à un commissariat (et pas à un haut lieu de la technologie électronique), on mange des nouilles. L’immeuble de JF Sebastien pourra tout à fait avoir été construit au début du 20ème siècle, dans un style baroque. Plongé dans la pénombre, il donne un accent gothique aux scènes qui s’y déroulent. Los Angeles est restée une ville avec ses quartiers ethniques où l’on parle aussi peu l’anglais qu’aujourd’hui.
On pourrait même réfléchir sur la place de l’industrie. N’est-il pas frappant en effet d’apercevoir une ville immense, dans laquelle il semblerait que l’industrie ait pris une place centrale, mais qu’au cours de l’histoire, il n’y ait aucune trace de cette activité parmi les hommes ? Les personnages sont flics, danseuse dans un bar glauque, généticien et fabricant d’androïdes, vendeurs, un groupe de voleurs de voiture… Pas d’activité en relation avec la production de biens. Le futur est donc le concentré d’une tendance qui s’est dessinée depuis longtemps au Etats-Unis (et dans le monde) : la désindustrialisation au profit d’autres types de marchés…
Le terme d’excroissance de la réalité est donc approprié. La mégalopole du futur imaginée sur la base de ce qui a été édifié nous questionne bien plus sur l’avenir qu’une trilogie de Star Wars qui, tout en étant du très bon cinéma hollywoodien, nous balade dans une irréalité telle que les films ressemblent plus à un conte féerique, alliage de lasers et de chevaliers de la table ronde, que du film d’anticipation.
L’accent réaliste et la fin ambiguë laisse donc un goût étrange, au final…
Les yeux de l’humanité.
Durant tout le film, on a l’impression persistante que le cinéma est mis en abîme. Le rôle du cinéaste dans l’histoire est évoqué à travers l’idée que finalement, la vie d’un homme se résume à sa vision, moins qu’à son rôle. Le héros ne maîtrise rien, et surtout pas sa propre destinée, puisque sa mission va lui être imposée dès le début. Il est noyé dans un flot que rien ne semble contrôler, pas même l’omniprésence de la police dans le labyrinthe de la ville.
La première image est celle de la découverte de la mégalopole, puis immédiatement, celle-ci se reflète dans un œil grand ouvert. Le lien entre le plan large de la ville et l’organe de l’homme dans lequel on aperçoit ce même plan est une indication sur la place du cinéma face aux évènements, à l’histoire. La vie, c’est la possibilité de voir le futur. L’homme n’est finalement qu’une immense accumulation de souvenirs.
Rachel d’ailleurs s’enfuira devant la révélation de son extériorité à l’espèce humaine : ses souvenirs ne sont pas les siens. Elle n’est donc qu’une invention, une disquette formatée pour se souvenir de choses non vécues.
Le cinéma a cette possibilité de fixer les souvenirs mieux que le cerveau, ainsi que de proposer une vision du futur, en inventant le monde de demain. Il est donc le témoin de l’histoire de l’humanité, l’œil de l’humanité.
Le désespoir du chef des réplicants sonnera de manière poétique dans ce sens quand, il dira finalement, avant de s’éteindre :
« J'ai vu des choses que vous autres ne croiriez pas. Des vaisseaux en flammes sur le Baudrier d'Orion. J'ai vu des rayons cosmiques scintiller près de la Porte de Tannhäuser. Tous ces instants seront perdus... dans le temps... comme les larmes... dans la pluie. Il est temps... de mourir. »
Tout semble se déterminer en fonction du regard. L’œil, le symbole de la vie, est l’organe par lequel on peut distinguer l’humain de l’androïde en pratiquant le test de Voight-Kampff. Ce test permet de vérifier le niveau de sensibilité des sujets face aux souvenirs (« parlez moi de votre mère, Léon ») ou face aux animaux (les androïdes n’ont pas de compassion vis-à-vis des animaux, contrairement aux humains).
La mort est assimilée aux souvenirs qui s’évanouissent. Batty, une fois arrivée auprès de son créateur (Tyrell) qui lui expliquera l’inéluctabilité de sa mort, choisira de le tuer, en lui enfonçant ses pouces dans les yeux, sous le regard impassible d’une chouette artificielle. De même, on notera que Léon (le premier des réplicants dans l’ordre d’apparition) cherchera à tuer Deckard (« Réveille toi, c’est l’heure de mourir ») en lui crevant les yeux. Son geste (deux doigts tendus au niveau du regard) sera stoppé par une balle, tirée par Rachel.
La vie c’est la possibilité de voir, d’enregistrer. La mort est la disparition de ces images. D’une certaine manière, le cinéma est un remède contre la mort, contre la disparition des images de l’humanité dans l’oubli. La science fiction vient ici nous rappeler l’importance des souvenirs dans la construction individuelle et collective d’une civilisation.
Des animaux et des hommes.
Un voile ambigu plane sur le film concernant les liens entre les humains et les animaux. Dans le livre, Philippe K. Dick insiste sur l’importance des animaux véritables, leur rareté et leur prix (le livre s’ouvre d’ailleurs sur une dispute concernant l’achat d’un véritable mouton). Cet élément est également soulevé dans le film, quand l’une des réplicante travaillera dans un bar à strip-tease avec un serpent. « c’est un vrai ? » demandera Deckard se faisant passer pour un membre du syndicat des travailleurs du Music Hall. « Bien sûr que non. Je bosserais ici, si je pouvais m'en payer un ? ».
De même, arrivant a la Tyrell Corporation, Deckard demande si le hibou est artificiel : « bien sur qu’il l’est » répondra Rachel.
Cette absence d’animaux véritables sera couplée avec l’apparition d’un grand nombre d’espèces exotiques rares (y compris une Licorne, qui formera le point d’interrogation sur la vraie nature du héros), ainsi que par l’analogie permanente entre les hommes et les animaux : Tyrell est associé à un hibou, Pris se déguisera en raton laveur, Batty hurlera comme un loup à la mort de cette dernière. Le héros est un prédateur, mais se retrouvera finalement dans le rôle de la proie.
L’immensité de la construction humaine, la dégradation sociale, l’absence de nature véritable, tout cela amène à ce que l’homme redevienne à l’état de primate. Le seul signe d’optimisme sera l’envol d’une colombe dans un ciel étonnamment bleu. Cette scène sonnera doublement faux : il est sensé pleuvoir et faire nuit dans cette scène d’une part ; la caméra reviendra immédiatement sur le regard du héros, confronté à sa propre mort d’autre part.
La naissance des sentiments : quels sont les plus humains dans l’histoire ?
En théorie, les androïdes ne connaissent pas les sentiments. Mais la science les a fait a ce point parfait que la compassion semble plus souvent de leurs côtés que de celui des représentants de la race humaine. La froideur est du côté de la foule anonyme, le chef des flics ne laisse pas le choix au héros, et semble heureux de donner les ordres sans possibilité de refus, l’ordre de tuer Rachel est donné de manière implacable (« dommage qu’elle doive mourir, mais c’est notre lot à tous »). L’annonce par Tyrell de l’inéluctabilité de la mort des androïdes est expliquée sans aucune compassion. Bref, tout semble indiquer que les sentiments ne sont pas du côté de ces humains qui ont transformé la terre en enfer et exterminé les animaux.
Au contraire, les robots montrent une grande tristesse (Batty pleure en annonçant la nouvelle de la mort d’une d’entre eux à Léon), un attachement fort à la personne et à la vie. La quête de ces androïdes est leur propre survie, le refus de se considérer eux-mêmes comme des machines programmées. Cette sensibilité face à leur propre sort (quand les humains ne semblent pas soucieux de leur avenir collectif) se ressent dans les propos des réplicants à l’égard de Deckard : « C'est dur de vivre dans la peur, hein ? » (Léon, après la mort de Zora, cherchant à tuer le héros), « Drôle d'expérience que de vivre dans la peur. Pas vrai ? » (Batty, voyant Deckard sur le point de tomber de l’immeuble). Il y a donc ici une volonté de faire partager leur peur face à la mort, de provoquer des sentiments, alors même que les réplicants n’étaient pas censés en développer.
Deux personnages auront un statut un peu particulier dans l’histoire : le héros lui-même, dont on ne sait pas vraiment qui il est (il n’a pas pratiqué le test de Voight-Kampff) et qui hésitera en permanence entre sa mission et ses sentiments. Il montrera également des doutes, voir un certain dégoût quant à son rôle devant sa triste tache. Ce désarroi est palpable lorsque Deckard contemplera le corps de Zora, sous une pluie de neige en polystyrène.
L’autre personnage à montrer ses sentiments, c’est JF Sebastien, cet ingénieur, créateur des Nexus-6 (modèle d’androïdes auxquels appartiennent le groupe des rebelles). L’évocation de sa solitude parmi ses amis robots et la marque d’affection de Pris (un rapide baiser dans le cou pour le convaincre d’aller voir Tyrell en compagnie de Batty) provoqueront des sanglots. Bien qu’humain, plusieurs éléments le rapprochent des Androïdes : son génome a été modifié par une maladie et conséquence de cela, sa durée de vie est extrêmement réduite, puisqu’il vieilli à grande vitesse (comme les Androïdes, bien vu) : paraissant 50 ans, il en a en réalité 25 (syndrome de « Mathusalem »). Si les androïdes sont prisonniers des colonies, lui est prisonnier de la terre puisque refusé lors de la visite médicale quand il voulut se rendre sur Mars.
Les rôles sont systématiquement inversés tout au long du film. L’apprentissage des sentiments par Rachel ira de pair avec la connaissance de sa conception artificielle. Alors qu’elle était présentée comme froide et hautaine durant la période où elle sera persuadée d’être humaine, elle montrera un premier signe de blessure intime lors de la révélation.
La ville qui a dévoré la nature, l’a détruite au lieu de la contrôler a également englouti les sentiments humains. Ces derniers émaneront de la création des hommes. La seule possibilité pour la renaissance de l’humanité semble résider dans ce qu’ont engendré les hommes de plus moderne.
Un conte cruel qui nous renvoie à notre propre présent et à nos responsabilités face au futur.
Quelques influences d’avant et d’après.
Si nous avons évoqué l’influence général du film noir et de ses codes, nous pouvons également nous arrêter sur des similitudes troublantes entre Blade Runner et le film de Fritz Lang : « Metropolis ». Outre qu’il est question là aussi d’une manipulation d’une androïde, la ville rappelle beaucoup celle de Scott. Le découpage horizontal recoupe là aussi un découpage social : les sommets sont réservés aux personnes importantes, socialement aisées, quand les bas fond sont peuplés de pauvres et de malformés. A noter que la fin du film fait écho à cette dissymétrie : la porte de l’ascenseur se referme sur Deckard et Rachel, et l’on ne sait pas s’il monte (vers la fange) ou s’il descend (vers l’espoir d’une vie meilleure). La seule image positive évoque également l’ascension vers le paradis : le vol de la colombe vers un ciel bleu.
Quant à l’après Blade Runner, on peut en apercevoir l’influence dans de nombreux films, dont certains n’en ont pourtant pas la force. Ainsi, on peut déceler des similitudes entre la ville de Scott et celle du film de Luc Besson, le « Cinquième Element » (voitures volantes, immensité des rues, nuages de fumée) ou bien celle de « Dark City » d’Alex Proyas (ruelles sombres, résolument noires et inhumaines), sorti en 1998.
On peut également apercevoir cette influence diffuse dans un manga de Mamoru Oshii, « Ghost in the shell » sorti en 1995. Plusieurs éléments font penser à une influence du film de Scott : la ville et l’ambiance sonore en premier lieu. Puis la thématique du lien entre la vie et la mémoire, avec les manipulations des personnalités, y occupent une grande place. Mais ce dernier aspect peut également se rapporter à l’influence générale de Philippe K. Dick qui a beaucoup traité de la manipulation de la réalité face au rapport entre le réel, concret et objectif, et ce qui résulte de la fiction/manipulation.
A noter qu’un remake version érotique est sorti au Japon sous le titre d’I.K.U., réalisé par Shu Lea Cheang. Sans intérêt, sauf que là, on sait ce qu’il se passe dans l’ascenseur une fois que la porte se referme (inutile de vous faire un origami).
Blade Runner est donc un film riche, très riche, dont le contenu fait encore l’objet d’un combat d’intérêts. Assurément, la version finale, très attendue, pourrait nous apporter une œuvre enrichie, aboutie.

Alexandre Lucresse